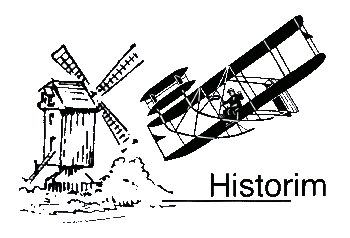Alors que ce sont les grandes vacances, consacrons un article aux écoles isséennes.
Sous la troisième République, les lois scolaires de Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique rendent l’enseignement primaire gratuit (loi du 16 juin 1881), laïque et obligatoire (loi du 28 mars 1882) pour tous les garçons et les filles de 6 à 13 ans. Dès 1880, le ministre Camille See avait créé les premiers lycées pour jeunes filles.
 École Paul Bert, carte postale,
École Paul Bert, carte postale, bâtiment de 1904, à l’angle des rues Aristide Briand et Paul Bert, avec son entrée monumentale maintenant fermée, annexée à l’actuel collège Victor Hugo.
École Voltaire, rue Maurice Champeau.
Elle a la forme sans doute la plus originale.
Son toit recourbé et couvert de plaques métalliques vertes protège le gymnase et un espace clos à ciel ouvert au-dessus des classes
le long de la rue Séverine.
Ce bâtiment est doublé par un majestueux escalier de plein air desservant les trois étages. La cour toute en longueur s’étend jusqu’à l’allée Saint-Sauveur.
Écoles Jean de La Fontaine rue de l’Abbé Derry. Les briques recouvrent la façade et la disposition des fenêtres évoquent le style de Le Corbusier. Outre les écoles maternelle et élémentaire, il y a aussi une crèche.
Écoles Louise Michel à l’extérieur du Fort,
rue du Docteur Zamenhoff.
Façade en bois disposé en lattes horizontales.
Les communes, dont c’est la responsabilité, doivent prévoir alors des écoles séparées pour filles et garçons. Si les établissements sont mixtes de nos jours, les écoles dépendent encore des communes, les collèges des départements et les lycées des régions.
Écoles des Épinettes dans un emplacement provisoire avenue de la Paix en attendant la construction de bâtiments neufs sur l’emplacement originel. Elles occupent les locaux de l’ancien collège de la Paix, lui-même déplacé à l’entrée du Fort.
Des bâtiments métalliques en forme de containers ont été rajoutés...
Certaines des premières écoles existent toujours. Elles étaient construites en meulière comme les écoles Jules Ferry (rue du même nom) ou Paul Bert dont le bâtiment de 1904 fait partie de l’actuel collège Victor Hugo.
Au cours des décennies, leur architecture s’est grandement diversifiée avec des façades en briques (écoles Jean de La Fontaine), en béton, en bois (écoles Justin Oudin ou Louise Michel au Fort, entrée de Marie Marvingt restaurée en 2023), voire en métal comme l’école Françoise Giroud au Cœur de Ville. Certaines écoles ont été déplacées comme l’école Voltaire ou les écoles des Épinettes.
En 2024, Issy compte 18 écoles maternelles et 16 écoles élémentaires dont certaines sont dans un même ensemble.
Les noms qui leur ont été donnés furent longtemps ceux d’hommes connus : des politiques comme évidemment Jules Ferry, des écrivains passés dans la commune comme Ernest Renan ou Victor Hugo et plus récemment, des photographes comme Robert Doisneau. De nos jours, ce sont des femmes qui sont mises à l’honneur comme Louise Michel ou Françoise Giroud, école la plus récente. Il y a également le nom de lieux isséens comme les Épinettes ou les Varennes. Le nom le plus original est celui d’une école maternelle Le Petit train vert (rue Eugène Atget), avec un dessin illustré sur la façade vitrée de l’entrée.
Texte et photographies : P. Maestracci